Face à des pratiques limitantes…
Face à l’ampleur des crises environnementales et sociales, l’enseignement se confronte à une tâche délicate : comment favoriser une compréhension réelle des enjeux sans décourager ou nourrir un sentiment d’éco-anxiété ?
Pour nous, une approche quantitative et factuelle des problèmes est certes importante, mais n’est pas suffisante, pour susciter le pouvoir d’agir des individus et des collectifs. Aussi, le Campus de la Transition met en œuvre une pédagogie originale, qui allie théorie et pratique, tout en accompagnant les personnes au plus près de leur expérience.
Nos formations s’adressent à un large panel d’apprenants : étudiants de l’enseignement supérieur et secondaire, enseignants, professionnels en activité et/ou en reconversion, et toute personne souhaitant s’engager.
Une vision systémique des enjeux de la « Grande Transition »
Dans le contexte écologique et social, parler de transition consiste à chercher à passer d’une situation contemporaine marquée par des trajectoires insoutenables à un état des sociétés caractérisé par la soutenabilité et l’équité, vis-à-vis des générations présentes comme des générations futures.
Derrière tous ces objectifs qui sont devant nous, de multiples questions se posent : comment assurer ces passages à partir de réalités marquées par le réchauffement climatique, la destruction du vivant, la pauvreté, les inégalités, les conflits pour l’appropriation de ressources, les incertitudes ?
La « Grande Transition » est donc systémique : à la fois écologique, sociale, économique, culturelle, politique, citoyenne…, elle se veut également « juste ».
Une pédagogie issue du « Manuel de la Grande Transition »
Le Manuel de la Grande Transition est issu d’une demande de la Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche. Il est le fruit du travail du collectif « FORTES » (Former à la Transition Écologique et Sociale de l’Enseignement Supérieur) constitué de 70 enseignants-chercheurs de différentes disciplines ainsi que quelques praticiens du monde de l’entreprise et des étudiants.
La méthodologie des 6 portes
Cette approche se traduit par la proposition d’un parcours en 6 portes, à traverser en ordre libre. Il s’agit de 6 angles d’approche différents qui ouvrent sur les enjeux de la transition depuis une perspective particulière (celle des sciences dites « dures », des sciences humaines et sociales, des sciences de gestion, du droit etc…).

« Oikos » : Habiter un monde commun
La Terre, la maison commune. Dans cette première entrée, le diagnostic se place du côté des sciences dures, identifiant les risques à rendre notre « planète inhabitable » et notre « monde invivable » et permettant de réfléchir à la façon de préserver les ressources qui s’épuisent.
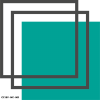
« Ethos » : Discerner et décider pour bien vivre ensemble
L’éthique, définie par le philosophe Paul Ricœur comme une recherche visant à « vivre bien, avec et pour les autres, dans des institutions justes ». Cet axe touche aux responsabilités communes – sociales, morales et politiques – pour nous engager collectivement vers l’horizon d’une société désirable.
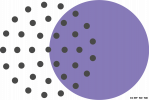
« Nomos » : Mesurer, réguler et gouverner
Ici sont convoquées des disciplines juridiques et économiques : les indicateurs actuels sont-ils pertinents ? Ne donnent-ils pas « priorité absolue à la croissance, sans se soucier des équilibres vivants » ? Le calcul du produit intérieur brut (PIB), par exemple, ne prend pas en compte les activités non monétaires et non marchandes. En cas de catastrophe naturelle, qui oblige à recourir à des moyens matériels, il augmente démesurément.

« Logos » : Interpréter, critiquer et imaginer
Le langage et la raison, qui invitent à interroger les récits de la transition. A l’expression de « changement climatique », faut-il préférer « l’urgence climatique » ? Le quotidien anglais The Guardian travaille à éviter la minimisation de ces questions par les lecteurs, qui pourraient être « endormis par un vocabulaire trop doux ». L’objectif étant d’être lucide, sans obéir à un catastrophisme pur.
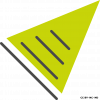
« Praxis » : Agir à la hauteur des enjeux
La pratique, l’action. Si un battement d’ailes à Tokyo a des retentissements au Brésil, comment trouver des logiques convergentes, relier les différentes échelles de mobilisations sociales et citoyennes ? Alors que les inégalités augmentent, peut-on continuer d’opposer « fin du monde » et « fin du mois » ? Mouvements des « gilets jaunes » et marches pour le climat ?
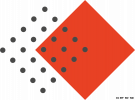
« Dynamis » : Se reconnecter à soi, aux autres et à la nature
Une reconnexion à soi et à la nature, favorisant une forme de résilience. Les traditions spirituelles, culturelles et religieuses peuvent-elles aider à traverser les catastrophes annoncées ? L’idée de « sobriété heureuse », avec des propositions concrètes comme la permaculture ou la création de monnaies locales, favorise à la fois le respect de l’environnement et la cohésion sociale.
Ces 6 portes permettent de ne manquer aucune des bonnes questions à se poser face aux défis de la « Grande Transition ». Savoir, savoir-être et savoir-agir s’y complètent et s’y enrichissent mutuellement dans une dynamique globale, intégrant la pédagogie ‘tête-corps-cœur’ mise en œuvre au Campus de la Transition depuis sa création : 6 portes qui ouvrent sur l’action.
Il s’agit « d’outils » mis à disposition de chacun, adaptables à chaque contexte et chaque profil de telle sorte qu’ils peuvent être utilisés en tenant compte de la problématique à traiter (un peu comme des briques de Lego).
La pédagogie Tête-Corps-Coeur
Pédagogie relationnelle et transformative
Cette pédagogie souhaite mobiliser à la fois la raison et l’éthique pratique, tout autant que la sagesse pratique, c’est-à-dire la relation à soi, aux autres et au monde. Il s’agit de construire une relation à soi, aux autres et à son environnement favorisant l’émergence d’un « vivre et faire ensemble ».
Pédagogie intégrative et holistique
Notre pédagogie permet de prendre en compte l’ensemble des dimensions de l’individu : son intellect, son savoir-faire et ses émotions. Elle mobilise la raison symbolique tout autant que l’intelligence logico-mathématique. Avec cette approche systémique, l’individu devient conscient de son apprentissage et de son lien au monde, et ne peut rester indifférent ou passif face aux enjeux.
Approche inter- et trans-disciplinaire
Notre approche interdisciplinaire vise à décloisonner les savoirs et les savoirs-faire, à valoriser le débat et le dialogue entre les rationalités à l’œuvre, les cultures et les visions du monde. Afin de saisir la complexité des défis, nous allons plus loin avec une approche transdisciplinaire via des projets de recherche-action et la valorisation de savoir-faire et de savoirs dits « non savants ».
Pédagogie enracinée et ouverte
Cette pédagogie souhaite limiter l’aspect « hors-sol » de la transmission des savoirs, en s’enracinant dans un territoire et dans des spécificités sociétales, tout en restant ouverte sur le monde et la diversité des cultures. Cela inclut le dialogue avec les acteurs du territoire et un dialogue interculturel.
Pédagogie relationnelle et transformative
Cette pédagogie souhaite mobiliser à la fois la raison et l’éthique pratique, tout autant que la sagesse pratique, c’est-à-dire la relation à soi, aux autres et au monde. Il s’agit de construire une relation à soi, aux autres et à son environnement favorisant l’émergence d’un « vivre et faire ensemble ».
Pédagogie intégrative et holistique
Notre pédagogie permet de prendre en compte l’ensemble des dimensions de l’individu : son intellect, son savoir-faire et ses émotions. Elle mobilise la raison symbolique tout autant que l’intelligence logico-mathématique. Avec cette approche systémique, l’individu devient conscient de son apprentissage et de son lien au monde, et ne peut rester indifférent ou passif face aux enjeux.
Approche inter- et trans-disciplinaire
Notre approche interdisciplinaire vise à décloisonner les savoirs et les savoirs-faire, à valoriser le débat et le dialogue entre les rationalités à l’œuvre, les cultures et les visions du monde. Afin de saisir la complexité des défis, nous allons plus loin avec une approche transdisciplinaire via des projets de recherche-action et la valorisation de savoir-faire et de savoirs dits « non savants ».
Pédagogie enracinée et ouverte
Cette pédagogie souhaite limiter l’aspect « hors-sol » de la transmission des savoirs, en s’enracinant dans un territoire et dans des spécificités sociétales, tout en restant ouverte sur le monde et la diversité des cultures. Cela inclut le dialogue avec les acteurs du territoire et un dialogue interculturel.
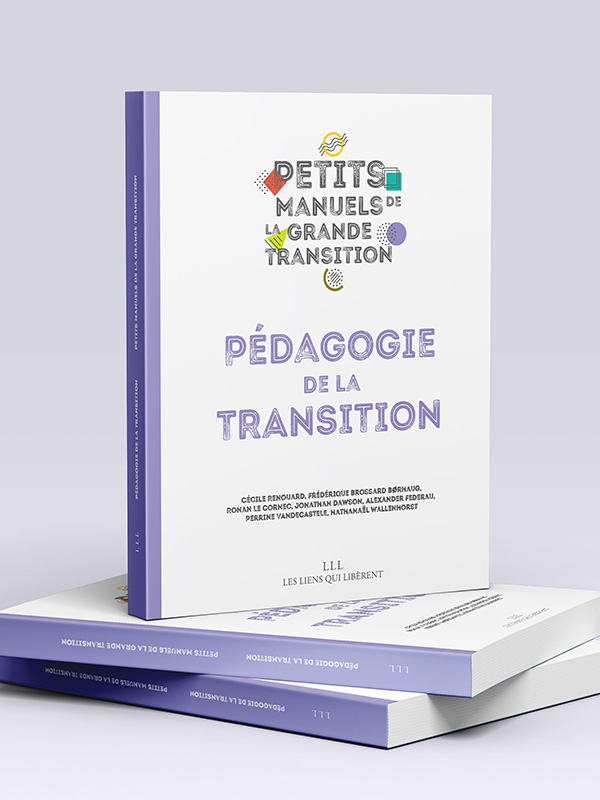
Des ressources pédagogiques
L’objectif du Campus de la Transition est d’outiller les citoyens pour agir à la hauteur des enjeux. Notre vision de la pédagogie se décline dès lors sur plusieurs plans. Tout d’abord, nous nous engageons dans le contenu de nos enseignements. Ainsi, nos formations rassemblent différents savoirs théoriques pertinents en lien avec les enjeux de transition, depuis des concepts émergents jusqu’à des savoirs oubliés et/ou sous-estimés. De même, nous favorisons le dialogue entre les disciplines et plaçons nos enseignements à la lisière entre théorie et pratique(s), que ce soit en diffusant les résultats de nos projets de recherche-action ou en insistant sur la mise en œuvre concrète des connaissances. Enfin, le Campus de la Transition s’attache à repenser la relation d’enseignement. L’association s’y emploie notamment en favorisant l’expression des émotions, en revalorisant les tâches manuelles et en créant un rapport d’horizontalité entre professeurs et apprenants.
Les objectifs de nos formations
Comprendre la dimension systémique des enjeux de Transition.
S’outiller pour passer à l’action.
Les objectifs de nos formations
Comprendre la dimension systémique des enjeux de Transition.
S’outiller pour passer à l’action.



Ancrer & Incarner : un écolieu au service de l’apprentissage de la Transition
Son ancrage au sein de l’éco-lieu du domaine boisé de Forges en Seine-et-Marne offre un terrain d’immersion et d’expérimentation privilégié pour faire le pas de côté nécessaire et se reconnecter à soi, aux autres et à la nature.
Plus qu’un enseignement classique circonscrit à l’espace d’un amphithéâtre, le Campus propose à travers ses formations sur son site une expérience holistique qui permet à chacun de s’éveiller et de s’ouvrir à la dimension collective et systémique de la Transition.
S’il privilégie l’enseignement in situ, le Campus propose néanmoins des formats à distance pour permettre à tous, et notamment à ceux qui sont géographiquement éloignés, de se former à la transition écologique et sociale.
Etudiants, professionnels, enseignants... Trouvez la formation faite pour vous
Pour les étudiants
Découvrez nos formations académiques
Pour les organisations
Découvrez notre offre de formation sur-mesure
A titre individuel
Découvrez nos parcours de formations professionnelles
Pour les enseignants
Découvrez notre offre de formations sur-mesure
